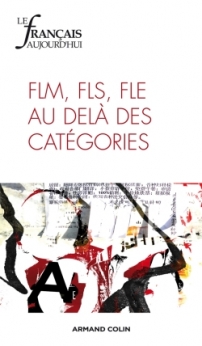
Le français aujourd'hui n° 176 (1/2012)
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
L’objectif de l’article est de tenter de répondre à la question suivante : sur quelles hypothèses la cou pure didactique FLE/FLM repose- t-elle ? La notion de locuteur natif, si contestée – et contestable – en sciences du langage, est au coeur du problème, dans la mesure où elle cristallise la relation entre identité et savoir linguistique légitime et que, de ce fait, elle est un levier puissant pour démêler les aprioris qui catégorisent les apprenants en natifs (à eux le FLM) et non- natifs (pour eux le FLE). Le modèle en continuum des « degrés de xénité » est-il suffisant pour permettre de sortir de ces découpages ? Rien n’est moins sûr, mais il est à comparer avec les modèles à l’oeuvre dans les domaines de l’inter compréhension – on se référe ainsi aux nombreux travaux théoriques et pratiques menés dans le domaine des langues romanes. La réflexion est illustrée à partir d’une étude de cas concret, menée sur le terrain dans le Pacifique Sud, à Wallis. L’observation permet de montrer que ces catégorisations sont peu efficaces au plan de la description et de l’analyse des interactions, et que le problème épistémologique posé par la coupure FLE/FLM est directement lié à la conceptualisation première que l’on se fait des pratiques langagières : pour valider la coupure, il faut également valider l’hypothèse de langues-entités distinctes, qui déterminent des locuteurs-identités aux contours finis. Cette modélisation semble mise en échec par l’observation des pratiques langagières en contexte plurilingue complexe.

