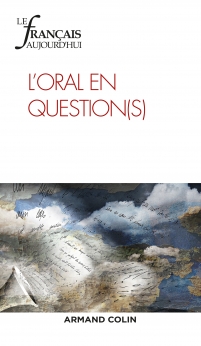
LE FRANÇAIS AUJOURD'HUI N° 195 (4/2016)
Pour acheter ce numéro, contactez-nous
Recevez les numéros de l'année en cours et accédez à l'intégralité des articles en ligne.
L’article aborde plusieurs points qui font l’objet de discussions ou d’interrogations récurrentes sur les questions d’oral. Tout d’abord, la frontière entre oral et écrit semble mise à mal avec des formes nouvelles et des lieux d’écriture (sms, tchats, forums). Or des travaux comme ceux de P. Koch et W. OEsterreicher (2001) apportent des outils de réflexion qui aident à mieux poser les différences. Ensuite, il convient d’observer la diversité des liens syntaxiques que la langue parlée exploite. À côté de marqueurs grammaticaux que l’on trouve tant à l’oral qu’à l’écrit, cette langue parlée recourt notamment à des liens de juxtaposition qui peuvent donner, à tort, l’impression que la syntaxe est absente ; l’analyse en termes de macrosyntaxe (Blanche-Benveniste 2010) aide à mieux comprendre l’organisation des énoncés. Enfin, la perspective des genres permet de sortir de l’opposition réductrice entre oral et écrit. Les genres requièrent, pour partie, un matériau grammatical spécifique. Il importe donc d’être sensibilisé à cet aspect pour pouvoir mieux observer et appréhender certains usages de la langue parlée. Des exemples variés empruntés à diverses sources (médias, corpus de Poitiers, corpusMPF) servent à préciser et illustrer les points traités.